
Protéger le littoral et préserver l’océan
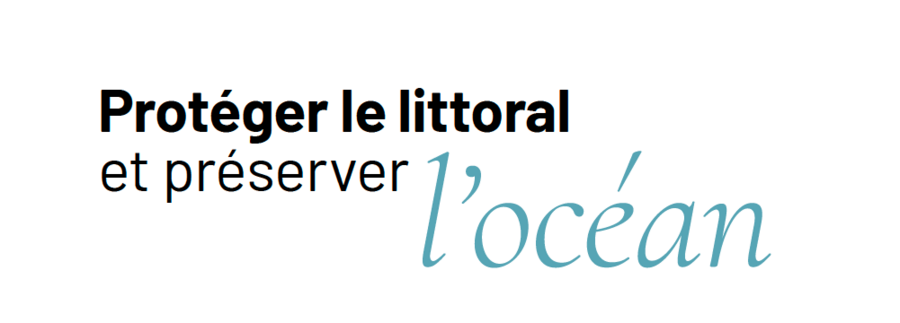
Éviter les débordements dans l’océan
« Ville balnéaire et touristique, Biarritz fait corps avec l’océan et place sa préservation au coeur de ses préoccupations, tout en protégeant son littoral de ses excès renforcés par le changement climatique. La qualité de son eau est surveillée par un dispositif éprouvé. Ses plages sont classées « excellente qualité » depuis 9 ans par l’ARS, gage des efforts consentis par une série d’investissements ambitieux dans l’assainissement. »
Géraldine Verget, Conseillère municipale déléguée à la sécurité du plan d’eau
Tel un amphithéâtre surplombant l’océan, la géographie de Biarritz fait converger tous les ruissellements pluvieux vers la Grande Plage, point bas de la ville.
Les réseaux de Biarritz construits au début du XXe siècle, sont majoritairement unitaires, c’est-à-dire qu’ils charrient simultanément les eaux pluviales et les eaux usées atteignant quelquefois des débits qui menacent le système. Les équipements d’assainissement permettent
en temps normal de faire transiter ces effluents sur l’ensemble du parcours du réseau pour les acheminer vers la station d’épuration afin qu’ils y soient traités avant rejet en mer.
Comme les épisodes de forte intensité météorologique augmentent et s’amplifient, il s’agit d’éviter que les cumuls de pluie, chargés de polluants terrestres ne se déversent dans l’océan, avant leur passage à la station d’épuration et n’altèrent la qualité des eaux de baignade.
Le maire, également vice-présidente à l’assainissement à la Communauté d’agglomération Pays Basque a permis des investissements massifs sur la commune pendant le mandat.
Ainsi, 10 millions d’€ ont été fléchés sur des travaux réalisés par la CAPB entre 2020 et 2026.
Sous les jardins de la Grande Plage, 2 réservoirs de 12 mètres de profondeur ont une capacité équivalente à 6 piscines olympiques. Pour optimiser leur remplissage, un nouvel ouvrage a été conçu et réalisé en 3 mois à peine de travaux : 2 chambres d’interception enterrées et une canalisation de jonction de 70 mètres de long capable de capter 6 à 8 m3 d’eau /seconde.
Dans le quartier de la Milady, l’imposant chantier d’installation d’un réseau séparatif s’est accompagné du renouvellement du réseau d’eau potable datant de 1930. La nouvelle canalisation pluviale est raccordée directement à l’émissaire existant vers le large.
Elle permettra de mieux sécuriser les eaux de baignade.
Cette question de l’eau passe par plusieurs actions dont la déconnexion des eaux pluviales est un enjeu majeur : l’objectif est de pouvoir laisser s’infiltrer l’eau de pluie là où elle tombe. De nombreux avantages en découleront : diminuer les eaux pluviales dans le réseau d’assainissement limitera les déversements vers le milieu naturel ; stocker transitoirement les eaux de pluie sous la chaussée permet également de baisser la température des voiries ; orienter les eaux infiltrées vers des fosses à plantation favorisera la revégétalisation qui participe de cette nouvelle logique.
Et aussi les polluants émergents
Des programmes de recherche sur les micro-polluants chimiques émergents et leur incidence sur le vivant sont en cours en lien avec l’IPREM, l’Institut pluridisciplinaire de recherche sur l’environnement de l’Université de Pau et du Pays de l’Adour.
Vigilance active des eaux de baignade toute l’année
Si la qualité des eaux de baignade des plages du littoral basque est contrôlée par l’Agence Régionale de Santé en haute saison, de mi-mai à mi-septembre, Biarritz informe également de la qualité de ses eaux toute l’année. Sous la compétence de l’Agglomération Pays Basque, la Ville, dans une démarche totalement innovante, a confié au groupe Suez et sa filiale Rivage Pro Tech l’analyse en temps réel de la qualité de l’eau, fondée sur la biologie moléculaire.
La modélisation numérique et l’intelligence artificielle ont permis d’aller plus loin, en croisant les données de prélèvement et celles des mouvements de la houle, de la météo et des déversements. Un gage unique de la qualité des eaux. Ce process innovant permet des mesures souvent à titre préventif. Elles conduisent la Ville à hisser la flamme violette par précaution en attendant les résultats biologiques permettant une réouverture des plages en totale sécurité pour les baigneurs.
D’autres phénomènes peuvent altérer la qualité de l’eau. Après la Méditerranée, la microalgue tropicale Ostreopsis s’est installée sur la côte basque. Depuis l’année dernière, le projet transfrontalier « Ostreobila » construit un protocole de suivi opérationnel harmonisé à tout le littoral : des prélèvements réguliers sont effectués jusqu’à 3 fois par
semaine, permettant de détecter la présence de l’algue.
Vers le zéro mégot
Les déchets terrestres sont responsables de 80% de la pollution maritime. Engagée dans le zéro mégot, Biarritz s’appuie sur le dynamisme de l’association Tree6Clope
et de son créateur Laurent Donse qui a importé le concept des cendriers interactifs et ludiques « ballot bin ».
La première filière française de collecte et revalorisation de mégots est née sur le littoral basque. Les volumes collectés sont massifiés au pôle technique municipal,
puis incinérés dans des unités spéciales au Sitcom 40 et transformés en énergie.
L’objectif territoire zéro mégot est aussi porté par le Conseil écologique et citoyen.
La Ville a confié à l’association la mise en place de cendriers interactifs personnalisés aux manifestations et fêtes locales (Les Casetas, Rat’s Cup, Festival Biarritz Amérique latine…).
La pêche aux déchets
Entre juin et septembre, le bateau rouge Haguna du Club de plongée et d’apnée BAB Sub Aquatique collecte, par un système d’épuisettes, les déchets flottants depuis le phare jusqu’à la Milady.
Un premier tri est effectué à bord avant de décharger la collecte dans les grands containers mis à disposition à quai par la Ville. Tout est pesé. À la fin de l’été 2024 : 350 kg ont été empêchés d’échouer sur les plages.
Plus au large, c’est l’« Itsas Belara » du syndicat Kosta Garbia qui, entre les embouchures de l’Adour et de la Bidassoa, assure le ramassage en mer. À terre, les plages sont nettoyées toute l’année. L’été, le dispositif devient quotidien.
Protection anti-submersion
Depuis les tempêtes hivernales de 2013/2014, Biarritz participe activement à la démarche collaborative de recherche pour mieux gérer l’impact des tempêtes, réunissant l’agglomération (pilote des risques littoraux), Rivages Pro Tech, les laboratoires universitaires et la coopération transfrontalière.
Coordonnés par Rivages Pro Tech, des outils d’observation et des outils de modélisation ont été créés pour anticiper et gérer au mieux les risques de submersion. La Ville a ainsi mis en place un dispositif d’alerte gradué alliant prévention, surveillance et intervention, allant de la fermeture des sites sensibles à l’installation de big bags le long de la Grande Plage.
Au fil des bulletins de prévisions, les habitants sont instantanément renseignés sur le site de la Ville et l’application de Biarritz. Actif toute l’année, c’est un dispositif pionnier qui permet de simuler et quantifier les risques évités. L’alerte préventive est une méthode d’adaptation.
Conforter les falaises pour protéger le trait de côte
Le confortement des falaises de la Côte des Basques est un engagement fort mêlant prouesses techniques et vision environnementale. Biarritz a fait le choix d’une lutte active contre l’érosion et a engagé des travaux colossaux. La phase débutée en janvier dernier (en pause pendant la saison estivale) s’étale sur 400 mètres de long, et consiste en la réalisation d’une paroi clouée en béton pour consolider l’ensemble. Des chemins sécurisés pour les marcheurs seront ouverts à terme pour rejoindre Marbella.
Pour éviter les ruissellements fragilisant la falaise, les eaux de pluie sont drainées en tête de falaise et renvoyées vers le milieu naturel via un réseau de drains.
La nature prend pleinement sa part avec une gestion singulière de l’espace et la création de talus végétalisés.
Avec le concours d’associations et entreprises d’insertion (Mifen), la lutte contre les espèces invasives (herbe de la pampa) a duré 2 ans, en attendant le retour de plantes indigènes, aujourd’hui en culture.
Kalilo, une application pour se mettre à l’eau
Inutile de se déplacer jusqu’à la plage pour regarder la couleur des drapeaux !
L’application Kalilo se télécharge gratuitement sur smartphone et renseigne sur les conditions de baignade évaluées sur site par les sauveteurs nautiques, sur la qualité de l’eau, les conditions météo et le risque Ostreopsis.
Dernière mise à jour le 21 juillet 2025





